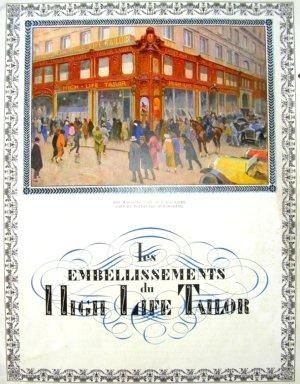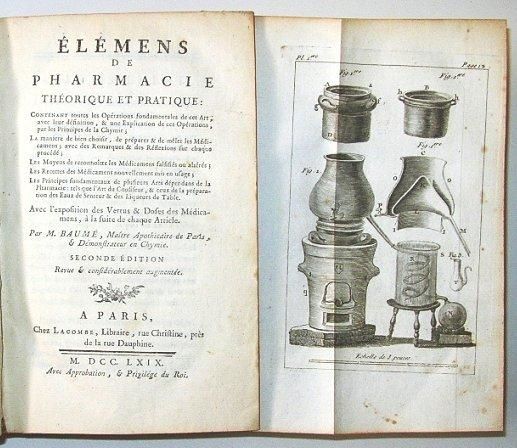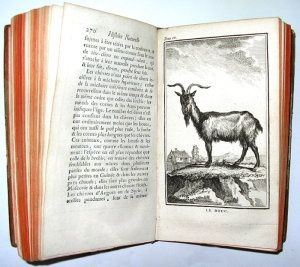Le gant est un accessoire de l’élégance indispensable autrefois. Il tient chaud, protège la main toujours laborieuse et sollicitée de la saleté et par là tout le corps. On y plonge les doigts comme on entre dans une douce société. Parfumé, il fait obstacle aux odeurs malsaines et répand le plaisir. Il est le dernier rempart entre soi et le monde, le premier médiateur. Il doit être fort et fin, confortable et gracieux. Dégantée, la main offre l’âme nue, invite plus chaleureusement, se donne cordialement, caresse. L’esprit qui guide chacun de nos mouvements et se prolonge dans nos yeux, notre visage, notre corps, nos habits, vient mourir dans le gant et s’agite en lui en un chant du cygne (ou signe). Il est l’accessoire de tous les muguets, coquettes, merveilleux, muscadins … Seuls la canne, la badine ou le parapluie marquent la frontière plus avant, pénètrent un peu plus l’univers. La main se dénude pour apprécier, aimer, toucher et partager … Elle ne quitte le confort du gant que pour entrer dans une autre douceur : s
Le gant est un accessoire de l’élégance indispensable autrefois. Il tient chaud, protège la main toujours laborieuse et sollicitée de la saleté et par là tout le corps. On y plonge les doigts comme on entre dans une douce société. Parfumé, il fait obstacle aux odeurs malsaines et répand le plaisir. Il est le dernier rempart entre soi et le monde, le premier médiateur. Il doit être fort et fin, confortable et gracieux. Dégantée, la main offre l’âme nue, invite plus chaleureusement, se donne cordialement, caresse. L’esprit qui guide chacun de nos mouvements et se prolonge dans nos yeux, notre visage, notre corps, nos habits, vient mourir dans le gant et s’agite en lui en un chant du cygne (ou signe). Il est l’accessoire de tous les muguets, coquettes, merveilleux, muscadins … Seuls la canne, la badine ou le parapluie marquent la frontière plus avant, pénètrent un peu plus l’univers. La main se dénude pour apprécier, aimer, toucher et partager … Elle ne quitte le confort du gant que pour entrer dans une autre douceur : s errer une main aimable, toucher de la soie, palper … L’habit et le gant sont la véritable compagne du dandy, sa conjointe, celle qui l’enlace constamment ; ainsi paraît-il toujours contenté, concentré et distant. Le monde entier peut s’écrouler sur lui, le dandy mourra en même temps que son apparence, son habit, son gant.
errer une main aimable, toucher de la soie, palper … L’habit et le gant sont la véritable compagne du dandy, sa conjointe, celle qui l’enlace constamment ; ainsi paraît-il toujours contenté, concentré et distant. Le monde entier peut s’écrouler sur lui, le dandy mourra en même temps que son apparence, son habit, son gant.
Photographies : Détail d’une gravure d’incroyable (1800) - Peinture polychrome sur porcelaine allemande du Directoire représentant une merveilleuse avec l’accoutrement typique : longue tunique vaporeuse, chapeau avec très longue visière. Signature au dos de Van Recum deFrankenthal (Allemagne), marque utilisée de 1797 à 1799. – Muscadin. Gravure de la première moitié du XIXe siècle. – Détail d’une gravure de 1797 représentant des incroyables.
L’Almanach de Gotha de 1789 qui contient « diverses connaissances curieuses et utiles » a tout un article (pp. 94-96) sur les « Gants » (l’orthographe a été changée car c’est écrit « gand ») : « Les gants sont une pièce d’ajustement très ancienne. Les premiers qu’on fit,  étaient sans doigts. Ce ne fut que dans le moyen âge, que les ecclésiastiques commencèrent à en porter. Dans l’ancien temps le don d’un gant, était la ligne de la cession d’une possession ; un gant jeté à une personne était un défi. En France, il était défendu aux juges royaux d’être gantés pendant leurs séances. On fait des gants, de peau, de toile, de laine, de coton, de lin, de fil, de soie etc. & des gants fourrés. […] On coupe ordinairement les gants de femmes tout d’une pièce excepté le pouce qu’on coupe à part dans toutes les espèces de gants, & le bord des gants d’hommes. Pour faciliter la coupe des gants on se sert d’un patron, ou modèle de papier, qu’on étend sur la peau. On dit que pour qu’une paire de gants soit bonne, il faut que trois royaumes y contribuent, c. à d. que l’Espagne doit fournir la peau, la France la coupe & l’Angleterre la façon. Les meilleurs gants blancs de France, se font maintenant à Paris, & à Vendôme. On portait autrefois des gants parfumés, qui venaient des royaumes d’Espagne & de Naples, les plus renommés étaient ceux de Nevoli, & de Franchipane cette mode est presque tombée… ». Pas tout à fait puisqu’en 1801 Jean-Louis Fargeon explique comment parfumer les gants dans L’Art du parfumeur, ou traité complet de la préparation des parfums, cosmétiques, pommades, pastilles, odeurs, huiles antiques, essences, bains aromatiques, et des gants de senteur, etc. Dans son Traité de la distillation avec un traité des odeurs, datant de 1753, Antoine Dejean occupe une partie aux gants. A cette époque, gantiers, poudriers et parfumeurs font partie de la même corporation. Parfumer les gants est même une des bases de l'art du parfumeur.
étaient sans doigts. Ce ne fut que dans le moyen âge, que les ecclésiastiques commencèrent à en porter. Dans l’ancien temps le don d’un gant, était la ligne de la cession d’une possession ; un gant jeté à une personne était un défi. En France, il était défendu aux juges royaux d’être gantés pendant leurs séances. On fait des gants, de peau, de toile, de laine, de coton, de lin, de fil, de soie etc. & des gants fourrés. […] On coupe ordinairement les gants de femmes tout d’une pièce excepté le pouce qu’on coupe à part dans toutes les espèces de gants, & le bord des gants d’hommes. Pour faciliter la coupe des gants on se sert d’un patron, ou modèle de papier, qu’on étend sur la peau. On dit que pour qu’une paire de gants soit bonne, il faut que trois royaumes y contribuent, c. à d. que l’Espagne doit fournir la peau, la France la coupe & l’Angleterre la façon. Les meilleurs gants blancs de France, se font maintenant à Paris, & à Vendôme. On portait autrefois des gants parfumés, qui venaient des royaumes d’Espagne & de Naples, les plus renommés étaient ceux de Nevoli, & de Franchipane cette mode est presque tombée… ». Pas tout à fait puisqu’en 1801 Jean-Louis Fargeon explique comment parfumer les gants dans L’Art du parfumeur, ou traité complet de la préparation des parfums, cosmétiques, pommades, pastilles, odeurs, huiles antiques, essences, bains aromatiques, et des gants de senteur, etc. Dans son Traité de la distillation avec un traité des odeurs, datant de 1753, Antoine Dejean occupe une partie aux gants. A cette époque, gantiers, poudriers et parfumeurs font partie de la même corporation. Parfumer les gants est même une des bases de l'art du parfumeur.
Voici quatre planches de l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et D'Alembert consacrées à la ‘Ganterie’ et aux gants et quelques passages de textes tirés du même ouvrage : « sous le nom de ganterie, l'on entend l'art  de fabriquer toute sorte de gants, espèce de vêtement de main destiné principalement à la défendre du froid pendant l'hiver, & du hâle pendant l'été. ». « Les gants se divisent en deux sortes: les uns qu'on appelle gants proprement dits, & les autres mitaines; les premiers sont aussi de deux espèces: les uns pour hommes sont les plus courts, & enveloppent les quatre doigts de la main & le pouce, chacun séparément, le métacarpe ou la paume & le carpe ou le poignet jusqu'au - dessus seulement; les autres pour femmes sont les plus longs, étant accoutumés à avoir les bras découverts; ils enveloppent comme les précédents non seulement les quatre doigts de la main & le pouce chacun séparément, quelquefois ouverts, & quelquefois fermés, le métacarpe & le carpe, mais même aussi l'avant-bras en entier jusqu'au coude. Les mitaines sont aussi des espèces de gants faits comme les précédents, mais dont les quatre doigts de la main sont ensemble & le pouce séparément; il en est de fermées & d'ouvertes; les unes servent aux paysans pour les garantir des piqures d'épines lorsqu'ils les coupent, & aux enfants pour leur tenir les mains plus chaudement, & les autres servent à presque toutes les femmes, lorsqu'elles vont en ville, en visite, ou en cérémonie, plus souvent par coutume que par besoin. »
de fabriquer toute sorte de gants, espèce de vêtement de main destiné principalement à la défendre du froid pendant l'hiver, & du hâle pendant l'été. ». « Les gants se divisent en deux sortes: les uns qu'on appelle gants proprement dits, & les autres mitaines; les premiers sont aussi de deux espèces: les uns pour hommes sont les plus courts, & enveloppent les quatre doigts de la main & le pouce, chacun séparément, le métacarpe ou la paume & le carpe ou le poignet jusqu'au - dessus seulement; les autres pour femmes sont les plus longs, étant accoutumés à avoir les bras découverts; ils enveloppent comme les précédents non seulement les quatre doigts de la main & le pouce chacun séparément, quelquefois ouverts, & quelquefois fermés, le métacarpe & le carpe, mais même aussi l'avant-bras en entier jusqu'au coude. Les mitaines sont aussi des espèces de gants faits comme les précédents, mais dont les quatre doigts de la main sont ensemble & le pouce séparément; il en est de fermées & d'ouvertes; les unes servent aux paysans pour les garantir des piqures d'épines lorsqu'ils les coupent, & aux enfants pour leur tenir les mains plus chaudement, & les autres servent à presque toutes les femmes, lorsqu'elles vont en ville, en visite, ou en cérémonie, plus souvent par coutume que par besoin. »
 Au sujet de la première planche : « De la manière de faire les gants. Les gants sont composés chacun de quatre sortes de pièces principales: la première est l'étavillon, (on appelle ainsi toute espèce de peau taillée ou non taillée, disposée pour faire un gant); la deuxième, qui est le pouce, est un petit morceau de peau préparé pour faire le pouce; la troisième, sont les fourchettes; ce sont aussi des petits morceaux de peaux à deux branches qui se placent entre les doigts pour leur donner l'agilité nécessaire; la quatrième, sont les carreaux. Ce sont de très petits morceaux de peau plutôt losanges que quarrés, qui se placent dans les angles intérieurs des fourchettes pour les empêcher de se déchirer, & en même temps contribuer avec elles à l'agilité des doigts. L'étavillon ainsi préparé, un autre ouvrier entaille les doigts, comme on peut le voir en ABCD, fig. 1. leur donne leur longueur, les rafile, fait les arrières fentes EFG, enlevure H, taille le pouce, fig. 2. les pièces de derrière, fig. 4… » « La fig. 1. Pl. I. représente un étavillon de gant simple, dont le côté I fait le dehors de la main, & le côté K le dedans; ABCD représentent les doigts, A est l'index, BB le medius & son correspondant, CC l'annulaire & son correspondant; EFG, sont les arrières fentes, & H l'enlevure. La fig. 2. représente le morceau de peau disposé pour faire le pouce; A est le haut du pouce, & B le côté qui se coud sur l'enlevure. La fig. 3. représente l'enlevure ou la pièce qui sort de l'enlevure A de l'étavillon (fig. 1.) ce petit morceau s'envoie à la couturière pour en tailler les quarreaux. La fig. 4. représente un morceau de peau en deux pièces A & B, dont on se sert quelquefois pour doubler le haut du gant I & K, fig. 1. La partie supérieure de la gravure montre des ouvriers dans leur atelier. »
Au sujet de la première planche : « De la manière de faire les gants. Les gants sont composés chacun de quatre sortes de pièces principales: la première est l'étavillon, (on appelle ainsi toute espèce de peau taillée ou non taillée, disposée pour faire un gant); la deuxième, qui est le pouce, est un petit morceau de peau préparé pour faire le pouce; la troisième, sont les fourchettes; ce sont aussi des petits morceaux de peaux à deux branches qui se placent entre les doigts pour leur donner l'agilité nécessaire; la quatrième, sont les carreaux. Ce sont de très petits morceaux de peau plutôt losanges que quarrés, qui se placent dans les angles intérieurs des fourchettes pour les empêcher de se déchirer, & en même temps contribuer avec elles à l'agilité des doigts. L'étavillon ainsi préparé, un autre ouvrier entaille les doigts, comme on peut le voir en ABCD, fig. 1. leur donne leur longueur, les rafile, fait les arrières fentes EFG, enlevure H, taille le pouce, fig. 2. les pièces de derrière, fig. 4… » « La fig. 1. Pl. I. représente un étavillon de gant simple, dont le côté I fait le dehors de la main, & le côté K le dedans; ABCD représentent les doigts, A est l'index, BB le medius & son correspondant, CC l'annulaire & son correspondant; EFG, sont les arrières fentes, & H l'enlevure. La fig. 2. représente le morceau de peau disposé pour faire le pouce; A est le haut du pouce, & B le côté qui se coud sur l'enlevure. La fig. 3. représente l'enlevure ou la pièce qui sort de l'enlevure A de l'étavillon (fig. 1.) ce petit morceau s'envoie à la couturière pour en tailler les quarreaux. La fig. 4. représente un morceau de peau en deux pièces A & B, dont on se sert quelquefois pour doubler le haut du gant I & K, fig. 1. La partie supérieure de la gravure montre des ouvriers dans leur atelier. »
 Sur la seconde planche sont représentées différentes sortes de gants : « Les gants retroussés ou à l'anglaise, fig. 12. & 13. sont ceux dont le haut A, étant en effet retroussé, l'envers qui devient l'endroit, est de même couleur & de même façon que le reste du gant. » « Les gants brodés, fig. 13. sont des gants dont le dessus de la main, vers la jonction des doigts, le pourtour de l'enlevure du pouce B, les bords du haut A, & presque toutes les coutures sont brodées en fil, soie, or ou argent, selon le goût & la distinction de ceux qui les portent, & les cérémonies où ils sont d'usage. » Quant à la description de la gravure la voici : « La fig. 5. représente la fourchette qui se place entre l'index & le médius, dont les bouts sont à pointe; la fig. 6. celle qui se place entre le médius & l'annulaire; & la fig. 7. celle qui se place entre l'annulaire & l'auriculaire. La fig. 8. représente le quarreau qui se place dans l'angle de la première fourchette; la fig. 9. celui qui se place dans l'angle de la seconde; la fig. 10. celui qui se place dans l'angle de la troisième. La fig. 11. représente un gant simple fait. La fig. 12. représente un gant à l'anglaise ou retrousse, fait; A est la retroussure. La fig. 13. représente un gant à l'anglaise, brodé; A A, &c. sont les broderies. La fig. 14. représente un étavillon de mitaine fermée; A est le dehors de la main; B le dedans; C l'enlevure. La fig. 15. représente un petit morceau de peau disposé pour faire le pouce; A est le haut du pouce; & B le côté qui se coud sur l'enlevure. La fig. 16. représente un morceau de peau en deux pièces A & B, fait pour doubler le haut de la mitaine A & B, fig. 14. La fig. 17. représente la mitaine faite. »
Sur la seconde planche sont représentées différentes sortes de gants : « Les gants retroussés ou à l'anglaise, fig. 12. & 13. sont ceux dont le haut A, étant en effet retroussé, l'envers qui devient l'endroit, est de même couleur & de même façon que le reste du gant. » « Les gants brodés, fig. 13. sont des gants dont le dessus de la main, vers la jonction des doigts, le pourtour de l'enlevure du pouce B, les bords du haut A, & presque toutes les coutures sont brodées en fil, soie, or ou argent, selon le goût & la distinction de ceux qui les portent, & les cérémonies où ils sont d'usage. » Quant à la description de la gravure la voici : « La fig. 5. représente la fourchette qui se place entre l'index & le médius, dont les bouts sont à pointe; la fig. 6. celle qui se place entre le médius & l'annulaire; & la fig. 7. celle qui se place entre l'annulaire & l'auriculaire. La fig. 8. représente le quarreau qui se place dans l'angle de la première fourchette; la fig. 9. celui qui se place dans l'angle de la seconde; la fig. 10. celui qui se place dans l'angle de la troisième. La fig. 11. représente un gant simple fait. La fig. 12. représente un gant à l'anglaise ou retrousse, fait; A est la retroussure. La fig. 13. représente un gant à l'anglaise, brodé; A A, &c. sont les broderies. La fig. 14. représente un étavillon de mitaine fermée; A est le dehors de la main; B le dedans; C l'enlevure. La fig. 15. représente un petit morceau de peau disposé pour faire le pouce; A est le haut du pouce; & B le côté qui se coud sur l'enlevure. La fig. 16. représente un morceau de peau en deux pièces A & B, fait pour doubler le haut de la mitaine A & B, fig. 14. La fig. 17. représente la mitaine faite. »
 Description de cette troisième planche : « La fig. 18. représente un étavillon de gant de fauconnier, dont le côté I fait le dehors de la main, & le côté K le dedans. ABCD représentent les doigts, A l'index, B B le médius, C C l'annulaire, & D D l'auriculaire; E F G sont les arrières fentes; & H l'enlevure. La fig. 19. représente la peau disposée pour faire le pouce; A est le haut du pouce; & B le côté qui se coud sur l'enlevure. La fig. 20. représente la fourchette qui se place entre l'index & le médius, dont les bouts sont à pointe; la fig. 21. celle qui se place entre le médius & l'annulaire; & la fig. 22. celle qui se place entre l'annulaire & l'auriculaire. La fig. 23. représente le quarreau qui se place dans l'angle de la première fourchette; la fig. 24. celui [p. 795] qui se place dans l'angle de la deuxième fourchette; & la fig. 25. celui qui se place dans l'angle de la dernière fourchette. Les fig. 26. & 27. représentent les deux pièces destinées à doubler le haut du gant. La fig. 28. représente un gant de fauconnier fait. La fig. 29. représente un étavillon de gant de femme à doigts ouverts, dont le côté I fait le dehors de la main, & le côté K le dedans. ABCD en sont les doigts; A les deux côtés de l'index; B B les deux côtés du médius; CC les deux côtés de l'annulaire; & D D les deux côtés de l'auriculaire; E F & G en sont les arrières fentes, & H l'enlevure. »
Description de cette troisième planche : « La fig. 18. représente un étavillon de gant de fauconnier, dont le côté I fait le dehors de la main, & le côté K le dedans. ABCD représentent les doigts, A l'index, B B le médius, C C l'annulaire, & D D l'auriculaire; E F G sont les arrières fentes; & H l'enlevure. La fig. 19. représente la peau disposée pour faire le pouce; A est le haut du pouce; & B le côté qui se coud sur l'enlevure. La fig. 20. représente la fourchette qui se place entre l'index & le médius, dont les bouts sont à pointe; la fig. 21. celle qui se place entre le médius & l'annulaire; & la fig. 22. celle qui se place entre l'annulaire & l'auriculaire. La fig. 23. représente le quarreau qui se place dans l'angle de la première fourchette; la fig. 24. celui [p. 795] qui se place dans l'angle de la deuxième fourchette; & la fig. 25. celui qui se place dans l'angle de la dernière fourchette. Les fig. 26. & 27. représentent les deux pièces destinées à doubler le haut du gant. La fig. 28. représente un gant de fauconnier fait. La fig. 29. représente un étavillon de gant de femme à doigts ouverts, dont le côté I fait le dehors de la main, & le côté K le dedans. ABCD en sont les doigts; A les deux côtés de l'index; B B les deux côtés du médius; CC les deux côtés de l'annulaire; & D D les deux côtés de l'auriculaire; E F & G en sont les arrières fentes, & H l'enlevure. »
Description de cette dernière planche : « Avant que de tailler les gants, il faut d'abord en préparer les peaux; pour cet effet on commence par les parer & en supprimer le pelun; si elles sont trop épaisses, ou plus d'un côté que de l'autre, il faut les effleurer, c'est - à - dire en ôter la fleur; ce qui se fait en levant d'abord du côté de la tête une lisière de cette fleur, qu'on appelle aussi canepin, & avec l'ongle on enlève cette petite peau peu-à-peu ; ce qui les rend alors beaucoup plus maniables & plus faciles à s'étendre. Ceci fait, après les avoir bien brossées & nettoyées, on les humecte très - légèrement du côté de la fleur avec une éponge imbibée dans de l'eau fraîche, & on les applique les unes sur les autres, chair sur chair, & fleur sur fleur; on les met ensuite en paquet jusqu'à ce qu'elles aient pris une humidité bien égale, & on les tire ensuite l'une après l'autre sur un palisson, figure 12. Planche V. en longueur, en  largeur, & en tout sens; les maniant ainsi tant qu'elles peuvent s'étendre; ensuite on les dépèce, & on les coupe pour en faire des étavillons, pouces, fourchettes, &c. Lorsque l'on veut faire un gant. ii faut préparer d'abord ses étavillons, ce qu'on appelle étavillonner; si la peau en est encore trop forte & trop épaisse, on l'amincit en la dolant; ce qui se fait en cette manière. On applique l'étavillon sur une table; on pose ensuite sur une de ses extrémités le marbre à doler, figure 5. Planche V. en sorte que son autre extrémité retourne par - dessus, que l'on tient de la main gauche bien étendue sur le marbre en appuyant dessus; on le dole, c'est - à - dire, on l'amincit, & on ôte en même tems toutes les inégalités avec le doloir ou couteau à doler, figure 6. Planche V. qu'on a eu grand soin auparavant d'aiguiser avec une petite pierre, & ensuite d'ôter le morfil avec l'épluchoir, figure première, Planche V. qui n'est autre chose qu'un mauvais couteau; l'on tient pour doler le couteau sur son plat de la main droite, en le faisant aller & venir successivement, jusqu'à ce qu'étant bien dolé partout, la peau en soit égale. Ceci fait, un ouvrier l'étend & le tire sur le palisson, figure 12. Planche V. ou sur la table fortement & à plusieurs reprises sur tous sens pour l'allonger, comme on a fait les peaux, plus ou moins, selon ses différentes épaisseurs, & toujours pour l'égaliser; ensuite il l'épluche & le déborde, c'est - à - dire, en tire les bords & les égalise avec l'épluchoir, figure première, Planche V. le plie en deux pour en faire le dessus & le dessous du gant, taille les deux côtés ensemble & les bouts selon la largeur & la forme convenables; ensuite le met en presse sous un marbre de pierre ou de bois à cet effet, figure 7. & 8. Planche V. jusqu'à ce qu'un autre ouvrier le reprenne pour le tailler, & on en recommence ensuite un autre de la même manière. » Voici la description de cette planche telle qu’on peut la lire dans l’Encyclopédie : « La fig. 1. Pl. V. représente un épluchoir, couteau fait pour servir à éplucher, déborder, &c. les étavillons; A en est la la ne, & B le manche. La fig. 2. représente une paire de ciseaux faite pour tailler les gants; A A en sont les taillans, B la charnière, & C C les anneaux. La fig. 3. représente une paire de forts ciseaux, faite pour couper ou dépecer les peaux; A A en sont les taillans; B la charnière; & CC les boucles. La fig. 4. représente une paire de forces faites pour dépecer les peaux, espèce de ciseaux à deux tranchants A A, & à ressort en B. que l'on prend à pleine main en C pour s'en servir. La fig. 5. représente un marbre à doler, d'environ un pied quarré, poli sur sa surface, sur laquelle on appuie les étavillons pour les doler. La fig. 6. représente un doloir ou couteau à doler, composé d'un fer A, très - large & très - taillant en B, emmanché en C, fait pour doler les étavillons. La fig. 7. représente une presse, pièce de bois simple d'environ deux pieds de long, faite pour mettre en presse les étavillons. La fig. 8. représente une autre presse de marbre d'environ un pied quarré, avec boucle au milieu en A, faite aussi pour mettre en presse les étavillons. La fig. 9. représente deux renformoirs d'environ quinze à dix - huit pouces de longueur chacun, espèce de fuseaux de bois de noyer ou de frêne, faits pour renformer les gants, c'est - à - dire les étendre. La fig. 10. représente une demoiselle, morceau de bois aussi de noyer ou de frêne, en forme de cône, d'environ un pied de hauteur, subdivisé de plusieurs espèces de boucles A A, &c. posées les unes sur les autres, dont le diamètre diminue à proportion qu'elles se lèvent, appuyées toutes sur un plateau B; cet instrument sert avec les renformoirs, fig. 9. à renformer les gants. La fig. 11. représente une petite demoiselle, faite pour servir à renfermer les gants d'enfant. La fig. 12. représente un palisson, fait pour étendre & allonger les peaux, composé d'un fer A, arrondi sur sa partie circulaire, arrêté à l'extrémité d'une plate - forme B, antée par l'autre sur une forte pièce de bois C, servant de pied, & retenue de part & d'autre par des arc - boutants D D; on se sert de cet instrument étant assis sur une chaise ou tabouret, ayant les pieds appuyés sur la machine, & faisant aller & venir sur le fer A, avec ses deux mains, les peaux que l'on étend. Article de M. Lucotte. »
largeur, & en tout sens; les maniant ainsi tant qu'elles peuvent s'étendre; ensuite on les dépèce, & on les coupe pour en faire des étavillons, pouces, fourchettes, &c. Lorsque l'on veut faire un gant. ii faut préparer d'abord ses étavillons, ce qu'on appelle étavillonner; si la peau en est encore trop forte & trop épaisse, on l'amincit en la dolant; ce qui se fait en cette manière. On applique l'étavillon sur une table; on pose ensuite sur une de ses extrémités le marbre à doler, figure 5. Planche V. en sorte que son autre extrémité retourne par - dessus, que l'on tient de la main gauche bien étendue sur le marbre en appuyant dessus; on le dole, c'est - à - dire, on l'amincit, & on ôte en même tems toutes les inégalités avec le doloir ou couteau à doler, figure 6. Planche V. qu'on a eu grand soin auparavant d'aiguiser avec une petite pierre, & ensuite d'ôter le morfil avec l'épluchoir, figure première, Planche V. qui n'est autre chose qu'un mauvais couteau; l'on tient pour doler le couteau sur son plat de la main droite, en le faisant aller & venir successivement, jusqu'à ce qu'étant bien dolé partout, la peau en soit égale. Ceci fait, un ouvrier l'étend & le tire sur le palisson, figure 12. Planche V. ou sur la table fortement & à plusieurs reprises sur tous sens pour l'allonger, comme on a fait les peaux, plus ou moins, selon ses différentes épaisseurs, & toujours pour l'égaliser; ensuite il l'épluche & le déborde, c'est - à - dire, en tire les bords & les égalise avec l'épluchoir, figure première, Planche V. le plie en deux pour en faire le dessus & le dessous du gant, taille les deux côtés ensemble & les bouts selon la largeur & la forme convenables; ensuite le met en presse sous un marbre de pierre ou de bois à cet effet, figure 7. & 8. Planche V. jusqu'à ce qu'un autre ouvrier le reprenne pour le tailler, & on en recommence ensuite un autre de la même manière. » Voici la description de cette planche telle qu’on peut la lire dans l’Encyclopédie : « La fig. 1. Pl. V. représente un épluchoir, couteau fait pour servir à éplucher, déborder, &c. les étavillons; A en est la la ne, & B le manche. La fig. 2. représente une paire de ciseaux faite pour tailler les gants; A A en sont les taillans, B la charnière, & C C les anneaux. La fig. 3. représente une paire de forts ciseaux, faite pour couper ou dépecer les peaux; A A en sont les taillans; B la charnière; & CC les boucles. La fig. 4. représente une paire de forces faites pour dépecer les peaux, espèce de ciseaux à deux tranchants A A, & à ressort en B. que l'on prend à pleine main en C pour s'en servir. La fig. 5. représente un marbre à doler, d'environ un pied quarré, poli sur sa surface, sur laquelle on appuie les étavillons pour les doler. La fig. 6. représente un doloir ou couteau à doler, composé d'un fer A, très - large & très - taillant en B, emmanché en C, fait pour doler les étavillons. La fig. 7. représente une presse, pièce de bois simple d'environ deux pieds de long, faite pour mettre en presse les étavillons. La fig. 8. représente une autre presse de marbre d'environ un pied quarré, avec boucle au milieu en A, faite aussi pour mettre en presse les étavillons. La fig. 9. représente deux renformoirs d'environ quinze à dix - huit pouces de longueur chacun, espèce de fuseaux de bois de noyer ou de frêne, faits pour renformer les gants, c'est - à - dire les étendre. La fig. 10. représente une demoiselle, morceau de bois aussi de noyer ou de frêne, en forme de cône, d'environ un pied de hauteur, subdivisé de plusieurs espèces de boucles A A, &c. posées les unes sur les autres, dont le diamètre diminue à proportion qu'elles se lèvent, appuyées toutes sur un plateau B; cet instrument sert avec les renformoirs, fig. 9. à renformer les gants. La fig. 11. représente une petite demoiselle, faite pour servir à renfermer les gants d'enfant. La fig. 12. représente un palisson, fait pour étendre & allonger les peaux, composé d'un fer A, arrondi sur sa partie circulaire, arrêté à l'extrémité d'une plate - forme B, antée par l'autre sur une forte pièce de bois C, servant de pied, & retenue de part & d'autre par des arc - boutants D D; on se sert de cet instrument étant assis sur une chaise ou tabouret, ayant les pieds appuyés sur la machine, & faisant aller & venir sur le fer A, avec ses deux mains, les peaux que l'on étend. Article de M. Lucotte. »